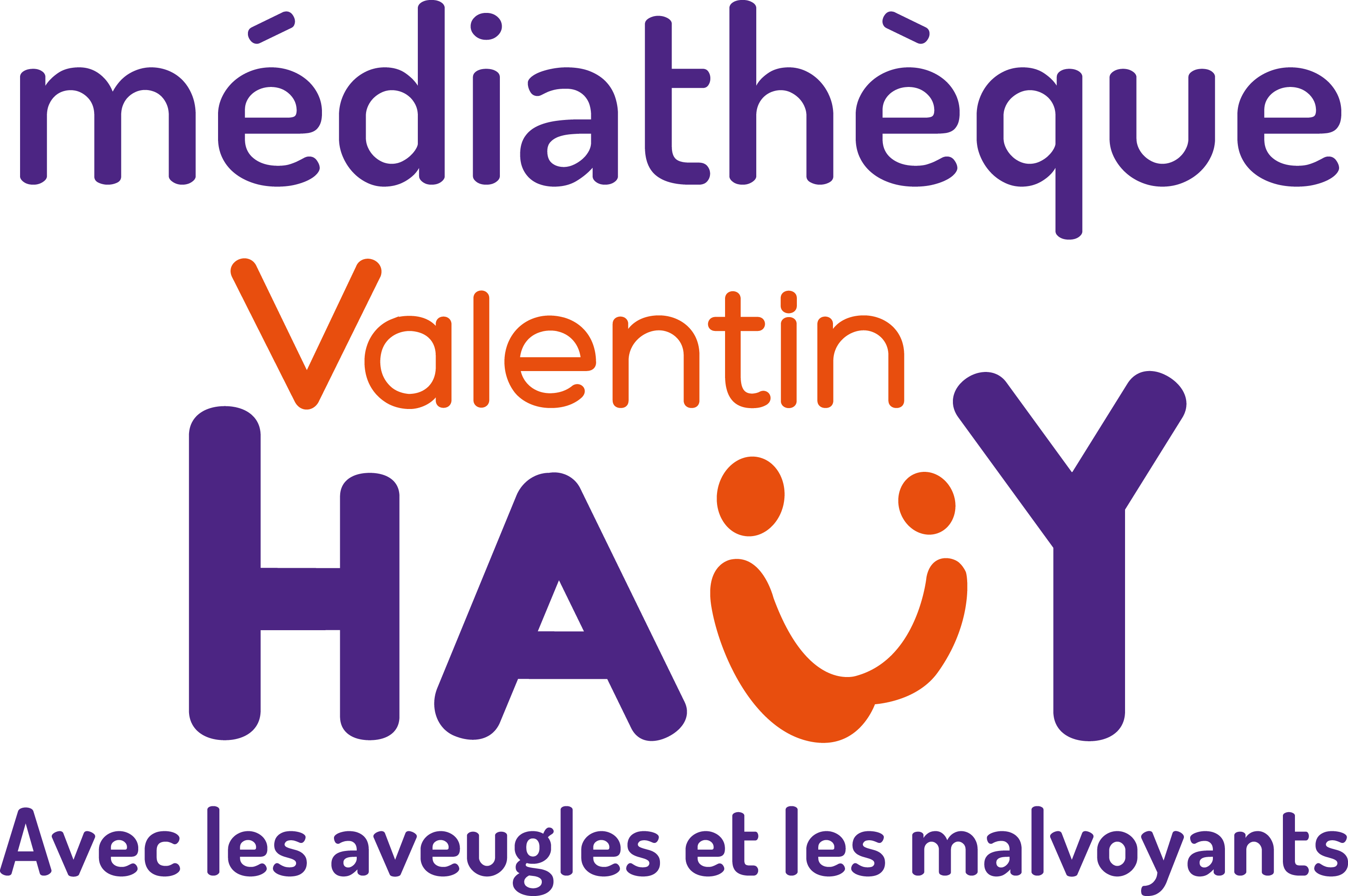Poésie

On aime les excès du poète Michel Garneau. On aime ses débordements langagiers, ses appropriations merveilleuses, ses trouvailles fantastiques, sa désinvolture totale. On aime qu'il rappelle que "tout le monde est poète" et que "c'est l'anarchie qui règne en poésie". On aime le Garneau jouisseur, libre penseur entre les morts, qui célèbre sa venue au monde tous les jours, on aime le Garneau généreux qui offre son cur et ouvre sa porte à celui ou celle qui habite comme lui les saisons de l'amour, "louchant sur la beauté des choses". Il faut lire Michel Garneau dans le silence des matins douillets ou à voix haute, mais sans modération aucune.

Voici le petit livre que Saint-Denys Garneau a entièrement voulu puis a presque renié ; c'est un chef-d'oeuvre, non seulement le sien, celui dont l'auteur recevait la maîtrise en poésie, mais aussi le nôtre, celui où la poésie québécoise a fini par découvrir l'orient de sa recherche.

Une Gauloise enfume le visage de ses seize ans. Elle danse et elle écrit pour hurler son silence. Puis, lasse de répéter la même tristesse, et accusant secrètement l'écriture d'être à la source du mal, elle arrête d'écrire. Cryptés, ces “ écrits de jeunesse ”, mal nécessaire, sont restés semés sur sa route, cailloux de Petit Poucet laissés à celle qui cherchait sans relâche en elle-même une faute qui ne s’y trouvait pas.

Un long poème en vers libres évoquant l'Europe et sa construction, les bouleversements liés à la révolution industrielle ou encore l'utopie de l'Union européenne, née à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2019

Ces poèmes engagés à l'humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent Gaudé.


Kaléidoscope mon cœur, c’est l’intérieur trouble et changeant d’une adolescente, comme les motifs en série d’un kaléidoscope. La narratrice, aux prises avec un trouble anxieux, vit avec la peur de ne pas être aimée, d’échouer, d’être exclue. Kristina Gauthier-Landry propose une poésie minimaliste avec une multitude de nuances allant de l’humour au drame qui permettent d’apprivoiser ce genre en douceur.

"La Comédie de la mort" (1838) fait référence à La "Divine Comédie" de Dante, mais le guide n’est pas Virgile. C’est une jeune morte, figure de la beauté, qui illustre la théorie de l’art.

Recueil d'une centaine de poèmes courts répartis en neuf chapitres.

A travers neuf textes poétiques, l'auteure poursuit sa quête métaphysique.